|
|
Bien que disponible gratuitement pour que tout le monde y ait accès sans barrière, ce document n'est pas pour autant sans valeur. Vous pouvez participer aux frais de création et de diffusion, en vous rendant à la page contact.
On sait les conséquences
des excès de la géométrisation de nos espaces de vie: coupure
d’avec la Nature dans une urbanisation forcenée; coupures de la Nature
par de grands chemins de fer, de béton, de goudron; déshumanisation
des lieux de travail et de vie. Déshumanisation au sens où, bien
que conçus par des hommes pour des hommes, ils ne sont
pas adaptés à leurs besoins profonds. C’est donc aux habitants
de s’adapter à eux, au prix d’un effort évident, source de mal-être
voire de maladies. Ajouter à cela la désynchronisation des rythmes
naturels par un éclairage nocturne excessif conduisant à une agitation
nocturne addictive, et l’on aura une idée plus complète de la
coupure, ultime aboutissement de la révolution amorcée au néolithique.
Normal peut-être que
l’on en soit arrivé à cette coupure et à cet enfermement
consentis lorsqu’on considère le principal moteur de cette révolution:
la peur. Peur de manquer, de ne pas avoir assez à manger lorsque des
hommes ont investi, de par leur curiosité naturelle ou repoussés
par leurs semblables, des territoires où la faune et la flore n’étaient
pas aussi abondants que sous les tropiques. Perte de cette état de confiance
que manifestent tous les autres êtres vivants, même ceux qui vivent
dans les régions les plus difficiles comme les déserts de sable
ou de glace.
Mais l’imagination qui a créé
le problème lui a aussi cherché une solution: conserver sur pied
des réserves de lait et de viande dans des animaux domestiqués;
faire pousser des stocks de graines dans des champs défrichés,
délimités, débarrassés de toutes les herbes non
utiles désormais étiquetées ‘mauvaises’.
Dure transition quand on sait
que la vie au néolithique était moins longue, moins agréable,
moins joueuse, moins joyeuse et évidemment plus laborieuse (même
racine que ‘labour’) qu’au paléolithique. Défi qui semblait tellement
surhumain qu’il n’a été rendu supportable que par l’invention
d’un paradis hors de ce monde à gagner en gagnant les grâces de
quelques divinités par l’intermédiaire de leurs servants autoproclamés.
À force de persévérance et au prix de grandes souffrances,
il a été surmonté, au point qu’aujourd’hui le travail d’une
faible portion de la population suffit à nourrir tous les autres. Chemin
faisant quelques esprits se sont libérés pour atteindre des hauteurs
sublimes tandis que la plupart des autres se sont enfermés dans les limites
du champ, de l’atelier, du château fort, de l’usine, du bureau…, lieux
bien clos et parfaitement géométrisés dans un grand élan
de géo-maîtrisation, toujours marques de peur et d’une pensée
elle-même close et limitée.
La plupart d’entre nous a si
bien intériorisé cet enfermement qu’il n’est même plus ressenti.
On peut éprouver du mal-être sans pouvoir en retracer la cause.
Il faut une rupture radicale de nos modes de vie pour réaliser cela.
Quelques jours en pleine Nature par exemple, ou bien la confrontation avec des
peuples plus primitifs. On comprend mieux alors pourquoi les ‘civilisés’
que nous sommes s’efforcent partout de les sédentariser: c’est que l’image
qu’ils renvoient nous gène. Pourquoi ne peuvent-ils vivre dans ces maisons
que les gouvernements leur octroient si généreusement, sinon à
grandes rasades d’eau de mort? pourquoi beaucoup se disent perdus de ne plus
dormir au contact de la terre sous le regard des étoiles?
Qu’on ne se méprenne
pas, je n’invite pas à retrouver le mode de vie paléolithique.
Je me borne à le confronter avec le nôtre pour mettre en exergue
ce qui, chez nous, va tellement de soi qu’on ne le perçoit même
pas, comme la perte d’intimité avec la Nature. Ce n’est pas nouveau évidemment.
Cela fait longtemps que certains, plus conscients que d’autres, nous alertent
et tentent d’y remédier, sans forcément vouloir remettre en cause
tous les acquis de la civilisation. Parmi eux quelques architectes, qui tournent
leur regard vers la Nature en quête d’une inspiration renouvelée.
La Nature, qui dans
l’acceptation la plus large du terme inclut la matière et les êtres
vivants, produit une variété quasi inépuisable de formes
en regard desquelles nos déclinaisons de la ligne droite, du carré
et du cercle paraissent bien pauvres. Il suffit d’observer la moindre fleur
ou le moindre mandibule du moindre insecte pour découvrir plus de richesses
en termes de formes et de structures que dans toute l’architecture et décoration
d’une civilisation.
Pire ou mieux selon le point
de vue, ces formes ne doivent pas grand chose à nos géométries.
Contemplant quelques sublimes réalisations humaines, des pyramides aux
ponts à haubans en passant par les cathédrales gothiques, on aurait
voulu croire en la réalité bénéfique et véridique
d’un espace de vie géométrisé. Reporter notre regard vers
la Nature apporte un démenti sans appel à cette croyance. On redécouvre
une richesse de formes mettant en jeu une grande variété de forces
formatives qui ne se ramènent pas à des tracés à
la règle et au compas, ni à des équations ou autres algorithmes.
Les êtres vivants ont
en outre ceci de fascinant qu’ils ne semblent pas limités par la matière.
Bien sûr ils restent soumis à ses lois et toute leur physiologie
n’est que physico-chimie. Pourtant ce qui préside à l’élaboration
de la forme globale d’une espèce n’est pas réductible à
ces lois. Nous avons vu dans la première partie les exemples du papillon
Kallima et de la fleur corail, nous en verrons d’autres plus loin qui montrent
sans conteste que pour la Vie, les règles de la matière ne sont
pas des limites contraignantes mais prétextes à jouer, à
se surpasser.
Non contente d’être infiniment
variées et de témoigner d’une imagination débordante, les
formes des êtres vivants sont en outre très efficientes. C’est
une tautologie, ce qui vit fait continuellement la preuve de son aptitude à
survivre. Quel architecte ne rêve de bâtiments où la forme,
la fonction et la structure s’accordent si bien? de bâtiments accordés
aussi au lieu, naissant d’un site précis tout en interagissant avec la
Terre entière et se nourrissant d’énergies cosmiques, celle du
Soleil notamment? de bâtiments adaptables, auto-réparables? conciliant
même éphémère et permanent, comme la fleur qui éclôt,
s’épanouit et se fane pour renaître l’année d’après?
Il faut dire que pour parvenir à ses fins la Vie soumet ses créations
à des tests impitoyables: le nombre, multipliant le même organisme
à des millions voire des milliards d’exemplaires, avec plus ou moins
de variantes, pour éprouver ses limites dans toutes les circonstances;
le temps, véritable défi de tout être incarné. L’architecte
ne dispose pas de ces tests parce qu’il n’a pas les mêmes défis.
Mais s’inspirant de la Nature, il peut espérer créer des formes
qui lui soient mieux accordées, mieux accordées aussi à
l’homme considéré à nouveau comme émanation
de la Nature.
Architecture naturelle,
architecture organique, vitaliste, etc., les dénominations ne manquent
pas. C’est que l’on n’a pas affaire à un style mais à une pluralité
d’approches qui ont principalement en commun de tenter de concilier ou réconcilier
l’homme et la Nature. Un homme multidimensionnel fait de raison,
d’intuition, de sensibilité, dont l’expérience d’être incarné
est indissociable de la Nature, tout en poursuivant des buts qui dépassent
ce plan d’existence. La Nature elle aussi est multidimensionnelle, avec ses
facettes visibles et ses dimensions invisibles (selon les cas: plan éthérique,
dévas, Gaïa, Dieu, etc.). Je crois que ce commentaire de Gary Coates
à l’œuvre de l’architecte d’inspiration anthroposophique Erik Asmussen
pourrait s’appliquer à la plupart de ceux qui se réclament d’une
architecture naturelle:
"Asmussen a compris que,
non content de répondre aux besoins pratiques de l’être humain,
la plus grande tâche de l’architecture est de donner un sens d’appartenance,
se sentir chez soi dans le monde naturel où l’on habite et dont sa vie
dépend entièrement en fin de compte. Il pense que le monde n’est
pas constitué d’une matière indifférente et dépourvue
de signification, mais plutôt que l’on existe dans une réalité
spirituelle-matérielle dotée d’une âme au sein de laquelle
on est relié au plus minuscule microbe et à la plus lointaine
étoile. En prenant conscience de sa place dans cette vaste trame de la
vie, Asmussen pense que l’architecture peut aider les gens à se connecter
aux forces curatives de la Nature pour nourrir et soutenir leur vie quotidienne.
Des bâtiments qui créent une harmonie avec la Nature et le site,
qui révèlent les principes par quoi la Nature elle-même
engendre des formes et les transforme, de tels bâtiments donnent la possibilité
de sentir que l’unité et la complétude de la Nature n’est pas
une idée abstraite de mystiques et de philosophes, mais plutôt
une réalité vivante dont chacun a l’intuition et pourra peut-être
un jour expérimenter directement." (Gary Coates, http://www.designandhealth.com/edu_res/Gary
J. Coates p239.pdf , traduction de l’auteur).
Les conséquences
de cette vision du monde dépassent bien évidemment le cadre de
l’architecture. On le voit bien dans les œuvres de Gaudi, qui a fait autant
de décoration et de paysagisme que d’architecture stricto sensu, de Frank
Lloyd Wright, qui a fondé Taliesin en 1911, une sorte de phalanstère
tout à la fois maison, communauté et école, de Steiner,
qui a touché tous les aspects de la vie de l’homme. Tels sont
d’ailleurs les initiateurs des principaux courants de l’architecture naturelle
qui ont traversé le 20e siècle.
Il est intéressant de
remarquer qu’ils se sont développés dans l’ignorance complète
les uns des autres. Ils sont autonomes, convergeant sur certains points et divergeant
sur d’autres. La convergence est visible dans le fait que quiconque observe
ces diverses réalisations trouve qu’elles tranchent avec l’architecture
traditionnelle et même parfois qu’elles ont un vague air de parenté.
D’où leur rattachement à ce mouvement multiforme qu’est l’architecture
naturelle. Quelques exemples:
 |
Antonio Gaudi, crypte de l’église Colonia Güell |
|
Frank
Lloyd Wright, maison Kaufman dite maison de la cascade, 1935-39
dans James Wines, l’architecture verte, Taschen 2000, p 23 |
|
 |
 |
|
Erik
Asmussen, clinique Vidar, 1985 |
|
 |
 |
 |
|
chapelle
mortuaire Farkasrét 1975
|
villa
Richter, 1983
|
villa
Dóczy, 1986-88
|
|
Imre
Makovecz
http://www.zenth.dk/research/index.html |
||
 |
Paul
Leech, maison taupinière |
Principaux points communs:
Ceci étant
les divergences ne sont pas moins grandes que les convergences. C’est que chacun
a sa définition de la Nature, chacun a son point de vue sur la manière
de s’en inspirer, chacun a son idée des ‘vrais’ besoins de l’homme.
Pour Gaudi (1852-1926), la
Nature est une manifestation de Dieu. "La ligne droite appartient à
l’homme et la ligne courbe à Dieu", ce qui veut dire que
déployer la ligne courbe dans une architecture revient en quelque sorte
à honorer voire à manifester Dieu.
Pour Wright (1867-1959)
la Nature est le seul et véritable corps de Dieu dans une vision
romantique, idéalisée, d’une Nature tranquille et apaisante dans
la lignée des Emerson et Thoreau. La ligne droite ne le gène pas,
et il travaille plus à harmoniser la construction avec son environnement
naturel et avec l’homme qu’à jouer avec les formes.
Pour Steiner (1861-1925) c’est
toute une anthroposophie, le nom de son mouvement, littéralement
une sagesse de l’homme, un homme aux multiples facettes, visibles
et invisibles, en lien avec un univers lui aussi aux multiples facettes visibles
et invisibles. Pour les deux bâtiments qu’il a construits dénommés
Goetheanum en hommage à son inspirateur Goethe (le premier ayant été
détruit par le feu), il a travaillé à la sensibilité
comme un sculpteur, façonnant la forme dans la glaise.
Lorsque je contemple
la plupart des formes issues de ces recherches et cogitations, je ne puis m’empêcher
de leur trouver une allure pas très naturelle. Dit autrement, je n’arrive
pas à imaginer la Nature concevant de telles formes en réponse
à un cahier des charges même réduit à: "enclore
un volume de quelques centaines de mètres cubes avec une surface principale
plane et quelques ouvertures sur l’extérieur". Manque d’imagination
de ma part ou de la part de ces architectes? J’ai beau regarder, je ne parviens
pas à voir dans ces bâtiments des expressions de la Nature, seulement
des limites de l’homme. Je suis même persuadé qu’un aborigène
australien ou un indien des plaines américaines n’y verrait pas davantage
des expressions de la Nature et ne souhaiterait pas y habiter.
Ce ne serait pas gênant
s’il n’y avait chez tous cette prétention à mettre en œuvre les
vrais principes par quoi la Nature elle-même engendre des formes. Il ne
suffit pas de remplacer quelques droites par des courbes, d’imiter des formes
existantes ou les pétrir avec sensibilité, ni encore d’insérer
le bâtiment parmi des arbres centenaires pour donner à une construction
un air naturel.
Bizarrement de nombreuses formes
conçues par Frei Otto ont à mes yeux une allure beaucoup plus
naturelle que celles conçues par des architectes étiquetés
organiques ou vitalistes ou naturels… Plusieurs exemples ont été
donnés dans le livre 1, en particulier
la grande halle de Mannheim ou la volière de Munich. Cela peut paraître
bizarre dans la mesure où ces formes n’imitent pas des formes connues,
et que d’autre part il recourt fréquemment à des matériaux
que l’on n’est guère tenté de qualifier de naturels comme l’acier,
le polyester, le PVC, l’acrylique, etc.
Il y a manifestement quelque
chose qui cloche quelque part. Où se cache donc le naturel? Comme toujours
dans notre regard. La question n’est donc pas de chercher une vérité
définitive en la matière. Il s’agit plutôt de se demander:
que considère-t-on être une forme ‘naturelle’? que cherche-t-on
à imiter lorsqu’on s’efforce de concevoir des formes architecturales
‘naturelles’? pourquoi certaines approches semblent donner de meilleurs résultats
que d’autres? quel sens cela a-t-il?
Distinguons:
Question: qu’est-ce qu’un insecte pour une grenouille? C’est évident: un moustique qui vole, une fourmi qui marche, un papillon posé sur une feuille… Quoique! Il ne s’agit là que d’exemples de ce que nous, êtres humains, percevons comme des insectes. La grenouille a peut-être un tout autre point de vue sur la question. Effectivement. Diverses expériences montrent que sa conception de l’insecte diffère considérablement de la nôtre. Son système perceptif est ainsi fait que l’insecte immobile n’est pas vu, tandis que celui en mouvement déclenche immédiatement une réaction de capture. Une grenouille n’a pas besoin d’apprendre ce qu’est une proie. Dès sa métamorphose elle happe tous les petits objets mobiles qui passent à proximité. Si ce système de perception en apparence simpliste a été conservé par la sélection naturelle, c’est que les connaissances qu’il permet à la grenouille d’acquérir sur le monde suffisent amplement à assurer sa survie. Il est en effet peu courant que des cailloux ou des brindilles se déplacent dans les airs, ce qui veut dire que la correspondance entre petits objets mobiles et insectes s’avère presque toujours réalisée. Nous, êtres humains, sommes sans doute capables de faire le détail entre une mouche et un moustique, et de voir l’identité entre une mouche qui vole et une mouche posée sur une vitre, mais nous sommes en contrepartie moins bien armés pour les capturer. Il est vrai que nous ne nous nourrissons pas d’insectes.
Donc ne confondons
pas la forme d’un objet avec l’apparence qu’il prend à travers le filtre
de notre perception. Cela a déjà été dit dans la
première partie mais ce petit rappel n’est sans doute pas inutile sachant
que nous sommes ainsi faits que nos perceptions du monde s’imposent à
nous comme réelles et comme venant réellement de l’extérieur.
A l’instar de la grenouille, ce n’est pas une tare, c’est un gage d’efficacité.
Jusqu’à un certain point évidemment. Comme elle, il nous arrive
de commettre des erreurs, de gober des brindilles qui volettent au vent que
nous prenons pour des insectes. Le sachant, nous pouvons essayer d’en éviter
quelques unes. Par exemple:
Combien de fois ai-je lu dans
des traités sur les formes des comparaisons osées entre la spirale
de l’ADN, la spirale de certains coquillages et la spirale des galaxies? Et
les auteurs de s’extasier sur de supposées correspondances macro-micro-cosmiques
sans voir qu’il ne s’agit que d’une construction de leur regard aussi étriqué que
celui d’une grenouille.
Le principal piège provient
du fait que ces objets ne sont jamais vus en trois dimensions mais seulement
sous forme de projections bidimensionnelles. Orientées dans le ‘bon’
sens, elles peuvent avoir un air de ressemblance suffisant pour justifier les
analogies. Mais si l’on poursuit l’exploration, il devient clair qu’une galaxie
vue par la tranche ne ressemble plus du tout au coquillage et encore moins à
une molécule d’ADN repliée en pelote (son état ordinaire).
Plus subtil mais tout aussi
efficace pour faire croire qu’il y a une réalité indépendante
là où il n’y a que projection de nous-mêmes, le piège
des mots: le fait d’affubler ces phénomènes très différents
d’un même nom, comme spirale, crée l’illusion qu’ils appartiennent
à un ensemble homogène, ensemble qui en fait n’existe pas parce
que ces formes sont aussi différentes qu’elles apparaissent semblables.
Si l’on en restait
à admirer le spectacle de la Nature et écrire des poèmes
l’exaltant, tout ceci serait fort beau. Le problème est que certains
n’hésitent pas à projeter à tort et à travers les
pseudo-vérités ainsi acquises, par exemple dans des réalisations
architecturales. C’est ainsi qu’un escalier ou un mur en spirale vont être
affublés du pouvoir magique de mettre en résonance l’être
humain qui y vit tout à la fois avec le microcosme via l’ADN et avec
le macrocosme via les spirales galactiques. Pour les raisons ci-dessus, cela
ne marche pas. Il se peut malgré tout que ces réalisations soient
élégantes et procurent un plaisir esthétique et/ou intellectuel
par cette idée même de correspondance qu’elles sont supposées
manifester. Mais ce n’est pas pour cause de véritables correspondances
cosmiques entre les formes ‘réelles’ de ces objets physiques.
Nous ne sommes pas des étoiles,
nous ne sommes pas des planètes, nous ne sommes pas des montagnes, des
insectes ni des plantes. Nos intentions ne sont pas les mêmes et par conséquent
les formes architecturales qui leurs correspondent ne sauraient être de
pures imitations de formes naturelles. Cela n’exclut pas que certaines réalisations
en viennent à ressembler à des formes naturelles. Mais ce n’est
pas par imitation, c’est plutôt, dirai-je, par évolution convergente,
de la même manière qu’une graine d’érable ressemblent à
une aile de libellules (du moins à nos yeux humains). Quoique différemment,
les deux permettent de voler, tout en manifestant des intentions très
différentes. Le point le plus notable en architecture est que la forme
d’un bâtiment est un volume ouvert délimité par une surface
alors que presque toutes les formes naturelles sont pleines. Il arrive que certaines
présentent des vides (par exemple les tiges de bambous) mais à
une échelle qui n’est pas du tout celle qui convient à une habitation.
Il faut particulièrement
se méfier des changements d’échelle. Je parle bien sûr d’une
transposition d’une forme naturelle dans la forme globale d’un bâtiment
et pas d’un simple placage décoratif. Le fait est que ce qui fonctionne
à une échelle ne fonctionne pas nécessairement à
une autre. Par exemple certains insectes courent littéralement sur l’eau,
l’homme lui ne le peut pas. Pourtant l’eau et les lois physiques auxquelles
elle obéit sont les mêmes pour l’un et pour l’autre. Disons pour
faire court que le volume d’un objet, et donc aussi sa masse, augmentent comme
le cube de sa dimension. Si l’on cherche à imiter une petite forme (un
coquillage, une fleur, le cocon d’un insecte, etc.) en augmentant sa taille
d’un certain facteur, disons 100, sa masse elle va augmenter du cube de ce facteur
soit 1 million. D’où des problèmes parfois insurmontables comme
la résistance de la structure à son propre poids.
On peut aussi vouloir rester
à la même échelle et employer des matériaux naturels
en imitant des structures naturelles, par exemple se servir d’un tronc d’arbre
en guise de mât. Sauf que cela n’a plus rien à voir avec un arbre:
pas de réseau racinaire, pas de matière vivante qui renforce automatiquement
la structure aux endroits de plus fortes contraintes, etc. Bref, c’est travailler
avec de la matière morte.
Dans tous les cas on se heurte
au problème de la perte de sens. Imiter des formes naturelles apparaît
comme une solution de facilité pour qui veut sortir l’architecture du
parallélépipède. Même si les formes ainsi conçues
sont attrayantes (pas toujours d’ailleurs), elles n’ont aucun sens, c’est-à-dire
aucun sens pour l’homme, elles ne sont pas faites pour lui. En prenant
le raccourci de l’imitation on évite la rencontre avec soi-même,
avec ses désirs et besoins profonds, et on évite la rencontre
avec la matière. On ne parcourt pas le chemin qui conduit à se
construire en construisant, pour construire alors en cohérence avec ce
qu’on est et ce qu’on a à vivre dans le monde.
Vues les limites d’une imitation pure et simples des formes naturelles, la tentative suivante d’élaboration d’une architecture se voulant naturelle consiste à mettre en œuvre les principes par quoi la Nature elle-même construit des formes. Cela signifie dans un premier temps mettre au jour lesdits principes puis dans un second temps les transposer à l’architecture. Selon l’inclination de chacun, on peut préférer imiter les forces formatives du vivant ou celles de la matière inanimée. Rudolf Steiner est un des principaux promoteurs de la première approche, Frei Otto de la seconde.
Rudolf Steiner (1861-1925)
est le fondateur de l’anthroposophie, véritable philosophie de l’homme
dans sa nature profonde. Sa métaphysique est d’une grande complexité.
Disons pour faire très court qu’il ne se contente pas de prendre en compte
des aspects visibles (la matière, le corps physique) mais également
des dimensions invisibles que lui révèle sa sensibilité:
l’éthérique (domaine de l’énergie vitale), l’astral (plan
de l’âme), le moi profond (l’esprit). Ces dernières ont pour lui
la plus grande importance puisque d’elles découlent l’organisation de
la matière. Steiner s’est efforcé d’appliquer ses théories
à tout ce qui touche l’homme: enseignement (écoles Steiner),
médecine (principalement inspiré par l’homéopathie d’Hahnemann),
agriculture (le mouvement biodynamique est son héritier), et aussi l’architecture.
Pour celle-ci il s’est principalement inspiré des idées de Goethe
sur les archétypes et la métamorphose des plantes, et il a à
son tour inspiré des architectes tels que Erik Asmussen ou Imre Makovecz.
Goethe (1749-1832) est sans
doute l’un des premiers en Occident à avoir pensé les formes en
tant que processus et non plus en tant que simple bout d’espace. C’est à
lui d’ailleurs que l’on doit le terme morphologie. Selon lui, toutes
les formes d’un règne sont engendrées par une sorte de plan archétypal.
Ainsi la forme de toutes les plantes se ramène à celle d’une plante
primordiale ou archétypale qui se matérialise à travers
plusieurs étapes évolutives mettant en jeu des forces complémentaires
de contraction et d’expansion. Contractée, la plante possède une
grande vitalité mais elle reste intériorisée, pas encore
pleinement active dans la réalité physique. Dilatée, elle
se déploie dans l’espace physique mais perd en contrepartie sa vitalité.
C’est une alternance sans fin: elle passe de la graine contractée aux
tiges et aux feuilles dilatées, se contracte à nouveau dans le
calice pour se dilater dans la fleur et se contracter dans l’ovaire, se dilate
dans le fruit qui redonne une graine contractée…
Ce jeu de polarisations successives
est complété par un jeu de métamorphoses. Dans la métamorphose
dite de développement, les formes qui apparaissent sont semblables aux
précédentes. Par exemple des feuilles nouvelles poussent, différentes
des précédentes en position et en taille, mais semblables dans
leur forme. Dans la métamorphose dite polaire, on assiste à un
changement de forme radical, et donc aussi à un changement des qualités
associées. La feuille laisse place à la fleur, la fleur au fruit,
etc.
Pour concevoir un bâtiment,
l’architecte procède d’abord à ce que Steiner appelle Einfühlung,
le fait de ressentir dans son corps comment vit le bâtiment et comment
on y vit. D’autre part, l’organischen Baugedanken, la pensée structurale
organique qui récapitules les idées de Goethe sur la morphogenèse
des plantes, permet à l’architecte d’appréhender les principes
générateurs. La combinaison des deux approches fait émerger
une forme naturellement conforme à la fonction.
Tout ceci semble assez sensé.
Pourtant les résultats ne sont hélas guère convaincants
ainsi que je l’ai déjà signalé. Pour être juste,
il arrive que des formes ainsi conçues soient intéressantes, mais
elles ne le sont ni plus ni moins que d’autres à base de géométrie,
et pas du tout pour le caractère naturel dont elles sont supposées
être imprégnées. Où est le problème?
D’abord pourquoi
vouloir faire de la formation des plantes le modèle général
de la morphogenèse architecturale? Pourquoi ne pas choisir d’imiter le
formation des mammifères ou des insectes ou des champignons ou de n’importe
quel autre grand règne du vivant? Il est évidemment toujours possible
de justifier ses choix, l’homme est un tel créateur de significations.
Steiner s’en tire en établissant une correspondance entre les trois systèmes
physiologiques du corps humain (neuro-sensoriel, rythmique et métabolique
selon sa classification) et les trois systèmes fonctionnels de la plante
(racines, feuilles, fleur). Il est vrai que dans un tel système de pensée
analogique, un bâtiment conçu sur le principe de la plante sera
à même de réunir l’homme qui l’habite et le monde
vivant environnant. Sauf que l’analogie homme-plante paraît un
peu forcée. Elle tient davantage selon moi de la projection anthropomorphe
que de la réalité de ces corps. Par rapport à la biosphère,
une plante manifeste d’autres intentions qu’un homme, et une maison d’autres
intentions qu’une plante. Il y a perte de sens à vouloir tout ramener
à la même chose.
Ceci dit on peut comprendre
la base du raisonnement analogique en remarquant que tous les êtres vivants
sur cette planète se nourrissent les uns des autres, se respirent les
uns les autres, sont constitués des mêmes molécules et surtout
du même code informationnel. Mais alors l’analogie n’est pas à
faire au niveau macroscopique entre l’espèce humaine et la plante. Ce
sont en fait toutes les espèces qui sont liées par leur physiologie
et analogues dans leur constitution intime. L’être vivant qui constitue
le plus petit dénominateur commun est alors la bactérie. D’elle
proviennent toutes les espèces par endosymbioses, chimérisation
et symbioses successives (voir le
grand roman des bactéries). On ne saurait évidemment reprocher
à Steiner de ne pas avoir tenu compte de faits inconnus de son temps.
On peut en revanche le reprocher à ses successeurs.
Comme expliqué
dans la première partie, l’essentiel de l’effet d’une forme tient au
sens qu’on lui donne (lequel opère principalement de manière inconsciente
je le rappelle aussi). Donc il est parfaitement légitime d’avoir envie
d’une maison qui ressemble à une plante dans son principe de génération.
Le problème alors est de savoir à quelles forces l’on a affaire.
Il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui plus grand monde, sinon quelques
anthroposophes, ne partage la conception goethienne de la morphogenèse
des plantes. Qu’il y ait à l’œuvre dans leur formation et leur évolution
des forces matérielles et des forces immatérielles, sensibles
et suprasensibles selon la terminologie de Goethe, cela n’est pas douteux (voir
plus loin le finalisme dans l’évolution des êtres vivants). Mais
que la manifestation sur le plan physique de la dimension suprasensible se ramène
à une succession d’expansions et de contractions, c’est un peu court.
Voici pour s’en convaincre un exemple étonnant.
Qu’est-ce que cette petite
formation de quelques millimètres de haut?
 |
dictyostelium
arbre |
Est-ce un petit champignon? un embryon d’arbre? Eh bien pas du tout, il s’agit d’une colonie de moisissures, Dictyostelium discoideum pour être précis, qui présente la particularité d’exister à la frontière entre unicellulaire et pluricellulaire, entre végétal et animal. Son cycle de vie est des plus curieux:
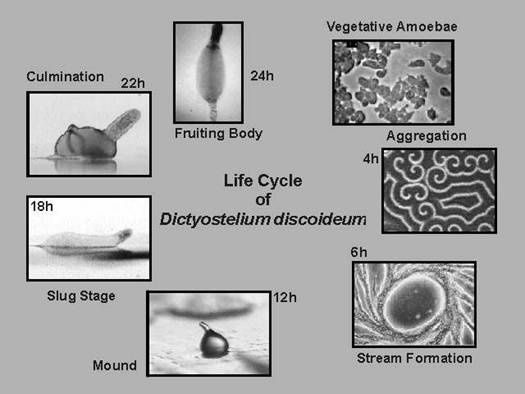 |
dictyostelium
cycle |
Isolées, les
cellules de Dictyostelium discoideum ressemblent à de grosses
amibes: figure en haut à droite (cette image correspond environ à
100 micromètres, et toutes les autres à environ 1 millimètre).
Elles se nourrissent de bactéries et de levures par phagocytose et se
reproduisent par division. Aussi longtemps qu’il y a de la nourriture, elles
mènent une vie indépendante sans se préoccuper de leurs
congénères. Lorsque la nourriture se raréfie, elles entrent
dans un nouveau cycle de vie. Les cellules sécrètent de l’adénosine
monophosphate cyclique (AMPc). Il est détecté par d’autres cellules
qui se mettent à leur tour à le sécréter tout en
se mettant en mouvement vers la source. Ces mouvements de foules engendrent
au bout de quelques heures de jolies formations spiralées (côté
droit, au milieu). Il est important de remarquer que ces formes résultent
‘naturellement’ de la seule concentration d’AMPc. Autrement dit, les gènes
de Dictyostelium discoideum ne contiennent aucune instruction sur la
forme que doit prendre la colonie à ce stade de son développement,
tout en contenant bien sûr le code pour synthétiser l’AMPc et le
détecter.
Le processus d’agrégation
de cent milles à un million de cellules se poursuit. Au bout de 18 heures,
la colonie ressemble à une limace. Bien que constituée de cellules
autonomes, elle se déplace comme un organisme pluricellulaire unique.
Parvenue à un endroit favorable plus sec, nouvelle transformation, cette
fois en une structure arborescente avec des ‘racines’, un ‘tronc’, des ‘branches’,
des ‘fruits’. Le tronc est en fait constitué d’organismes morts qui se
sont sacrifiés pour le groupe. Les cellules vivantes forment au sommet
un organe fructifère, le sporocarpe. La comparaison avec un fruit n’est
pas outrée dans la mesure où là se forment des spores qui,
comme des graines, sont libérés à maturité et transportés
par le vent pour recommencer un nouveau cycle ailleurs.
Dictyostelium discoideum
est une espèce vraiment étonnante. On voit clairement combien
nos intentions sont éloignées de tels êtres et on comprend
combien ce serait un erreur de vouloir en tirer des règles générales
de morphogenèse architecturale.
S’inspirer de forces formatives biologiques pour construire des maisons, pourquoi pas à la limite, mais à condition de prendre ces réalisations pour ce qu’elles sont, des témoins de la créativité de l’homme et des expressions de ses intentions, et les forces formatives supposées pour ce qu’elles sont elles aussi, de simples hypothèses à vocation heuristique. Problème il y a lorsqu’on a la prétention de croire qu’une vérité des formes architecturales a été découverte, et que de là va découler nécessairement une architecture accordée à la Nature et à la nature de l’homme. Si ce sont là les objectifs que l’on souhaite atteindre, il est clair qu’il faut procéder autrement.
Lorsqu’on accroche
un câble par ses extrémités et qu’on le laisse pendre librement,
il prend une forme par le seul jeu de forces physiques: la gravité d’une
part, et d’autre part les forces interatomiques dans le câble qui lui
donnent sa cohésion et assurent sa résistance à la tension.
Lorsqu’on plonge un contour
en fil de fer dans de l’eau savonneuse et qu’on le retire, reste un film qui
prend forme par la seule action de forces physico-chimiques.
Toutes ces formes peuvent être
qualifiées de naturelles dans la mesure où elles sont entièrement
le résultat de processus naturels.
L’architecte peut employer
de tels processus pour élaborer les formes de ses structures. À
leur tour elles peuvent être qualifiées de naturelles bien qu’elles
n’existent pas dans la Nature antérieurement à l’action de l’architecte.
En effet, la Nature ne fabrique pas des arches en suspendant des câbles,
les rigidifiant et les retournant (voir livre 1,
première partie); la Nature ne fabrique pas des membranes de plusieurs
centaines de mètres carrés en agrandissant des films d’eau savonneuse
de quelques centimètres carrés (voir livre 1,
troisième partie).
Le plus remarquable est que
ces opérations non naturelles ne font pas perdre à ces formes
leur air naturel. Probablement parce que nous avons dans notre inconscient cognitif
tout un ensemble de connaissance sur ce qui constitue un objet physique valide.
Expérience: munissez-vous de quelques photos, un arbre, une montagne,
un visage par exemple, et observez-les à l’envers. Étrange sensations
n’est-ce pas? comme un air irréel. Eh bien les formes architecturales
élaborées grâce aux procédés ci-dessus gardent
à nos yeux un air réel. Plus précisément elles pourraient
être véritablement des formes nées dans la Nature même
si on les sait conçues par l’homme (par l’emploi notamment de
matériaux comme le béton, l’acier ou le verre…).
Tel est le principal intérêt
de la démarche: elle est nécessairement ‘vraie’ puisque le résultat
est déterminé par le jeu de forces physiques et non par l’application
de théories hypothétiques. Cette part d’indétermination
que l’architecte doit laisser pour que les forces de la Nature jouent est essentielle
comme le souligne Frei Otto: "Le désir de créer délibérément
une figure précise est en contradiction avec la recherche d’une forme
qui, encore à découvrir, est soumise aux lois de la Nature."
(Frei Otto, lighweight construction, natural design, complete works,
Birkhaüser 2005, p 18, traduction de l’auteur).
Il va de soi que
l’intervention de l’architecte est non moins essentielle. C’est lui qui définit
les limites entre lesquelles les forces physiques vont être laissées
libres de jouer. Plusieurs exemples ont été données dans
le livre 1 et le lecteur intéressé
en trouvera davantage dans l’ouvrage sur Frei Otto juste cité ainsi que
sur http://www.freiotto.com.
Il ressort de ce panorama: d’une part l’immense variété de formes
conçues qui montre la souplesse du procédé; d’autre part
leur grande beauté ‘naturelle’.
Il faut dire que Frei Otto
met son art au service d’intentions élevées:
Ajoutons que Frei Otto a eu une préoccupation écologique longtemps avant que ce soit à la mode, allant même plus loin que beaucoup aujourd’hui. Selon lui, couvrir une façade ou un toit de plantes a certes un intérêt écologique mais ne suffit pas à faire de l’architecture écologique. Pas davantage le fait de modifier la forme pour la rendre plus naturelle en apparence. Le facteur crucial est l’économie de matière et d’énergie. Pour information, de l’ordre d’un mètre cube de béton est coulé par personne et par an sur l’ensemble de la planète, tous types de travaux confondus. Donc rechercher la légèreté, l’optimum de la forme-structure, construire avec le moins possible. Étant précisé qu’il ne s’agit pas de battre des records mais de créer de l’espace pour les gens et pas pour y accumuler des matériaux, de rendre les bâtiments facilement modifiables et adaptables à des besoins changeants, d’être ouvert sur la Nature.
Peut-on dire qu’il
a réussi? Sans aucun doute. A-t-il toujours réussi? Bizarrement
il est un domaine où ses réalisations sont très en deçà
des attentes, les maisons. Frei Otto en a conçues très peu et
celles qu’il a construites, dont la sienne, n’obéissent pas du tout aux
principes morphogénétiques qu’il a mis en œuvre dans tous ses
autres projets. Elles ont d’autres qualités, notamment bioclimatiques,
mais sur le plan de la forme elles restent traditionnelles, à base de
lignes droites. Comment expliquer ce décalage?
D’abord par le fait que la
méthode est difficile à mettre en œuvre: "Il est extrêmement
difficile d’appliquer des processus d’auto-formation à la conception
architecturale. Même si les expériences constituent une voie directe
pour délimiter la forme qui, par nature, est déjà optimisée,
la conception doit aussi être considérée en relation avec
la complexité du travail de construction ainsi que l’intégration
du bâtiment dans son environnement et la société."
(p 18) Donc beaucoup de travail et d’essais, beaucoup de compétences
et de soin exigés, que l’on peut se permettre d’investir sur de grands
projets mais guère dans une simple maison.
L’autre problème est
que ces structures minimales ne sont parfaites qu’en tant qu’abris ouverts.
Dès qu’on doit les adapter pour répondre aux normes actuelles
de confort d’une maison en rajoutant huisseries rectangulaires, isolation, chauffage,
en partitionnant l’espace pour créer des sanitaires et autres pièces
séparées, les choses deviennent encore plus compliquées.
Du coup le résultat final s’en ressent, perdant en élégance,
en légèreté, en naturel.
Qu’on le veuille
ou non, qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, la seule vérité
qui ressort de ces considérations sur les formes naturelles se réduit
à ceci: regardant la Nature, ce n’est jamais que son propre esprit que
l’homme contemple. Dans son regard se révèlent ses croyances
quant à ce qui est lui et ce qui est hors de lui; dans les formes qu’il
délimite se révèlent son inconscient instinctif, cognitif,
psychologique; dans ses sentiments se révèlent ses attentes, ses
désirs, ses peurs…
On pourrait en rester à
ce jeu de miroir. C’est d’ailleurs ce que fait l’homme depuis des millénaires.
De là, entre autres, une architecture qui lui ressemble. Cette hutte
ronde dans ce village en cercle est bien celle d’un homme sans individualité,
dans un univers sans changement, clos, dont le bord n’est qu’à quelques
heures de marche après quoi est le domaine des dieux, tabou. Cette maison
carrée dans ce champ carré est bien celle d’un homme si
craintif de la Nature que son seul espoir de survie est la géo-maîtrise
de son enclos, avec l’aide d’un dieu devenu inaccessible, repoussé dans
le ciel, dans un premier temps encore visible dans l’astre solaire et puis totalement
transcendant.
Et l’on pourrait continuer
comme ça longtemps, jusqu’à tenter de géo-maîtriser
la Terre entière. Sauf qu’à voir et à vivre aujourd’hui
les effets de plus en plus néfastes de cette Vision du monde, on peut
être tenté de s’en distancier dès à présent,
ne plus la faire sienne même si l’on ne sait trop par quoi la remplacer.
En tout cas beaucoup ne se reconnaissent plus dans les anciennes formes émanées
d’elle. Elles n’inspirent plus. Pour nourrir de nouveaux rêves et aider
à les impulser dans la matière, on pressent le besoin d’une nouvelle
architecture qui soit support d’évolution. Dans ces conditions il peut
être utile de jeter un nouveau coup d’œil sur la Nature, différent
des précédents, pour voir comment elle procède pour faire
évoluer ses espèces.
L’ontogenèse,
c’est le processus de développement d’un individu à partir d’un
œuf fécondé; la phylogenèse, c’est le développement
évolutif d’une lignée. Bizarrement la quasi totalité des
études sur la morphogenèse des êtres vivants se concentre
sur l’ontogenèse, la construction de l’organisme, et élude la
phylogenèse. C’est-à-dire que cela semble bizarre pour quelqu’un
qui, comme moi, trouve la question de l’évolution de l’homme des
plus importantes. C’est normal en revanche si l’on n’a pas envie d’être
bousculé dans les certitudes que l’on tient à son sujet. Mais
l’histoire des quelques derniers millénaires le montre bien, si l’on
en croit évidemment les scientifiques, notre espèce existe depuis
peu et elle n’est pas appelée à durer éternellement. Dure
réalisation! Déjà que beaucoup ont du mal à appréhender
leur propre histoire, celle de leurs lignées familiales, celle de leur
pays, alors imaginez le saut que cela représente de penser l’humanité
dans son ensemble et dans sa trajectoire évolutive multimillénaire,
elle-même inscrite dans celle de tout-ce-qui-vit, elle-même inscrite
dans celle de tout-ce-qui-est. Rassurez-vous, cette étude sur les formes
architecturales ne va pas se transformer en une histoire de l’univers. Je vais
me contenter de diriger notre attention sur quelques faits inspirants.
Mais où les dénicher
tant il est vrai qu’étudier l’évolution des espèces n’est
pas facile. Notamment parce que la vie d’un humain ne se déroule pas
à la même échelle de temps. Et aussi parce qu’il faut naviguer
entre ces écueils où se retrouvent: d’une part ceux qui prétendent
qu’un dieu omni-tout a tout créé en quelques jours pour se désintéresser
ensuite de sa création; et d’autre part ceux qui veulent nous convaincre,
pour recueillir nos subsides sans doute, que tout ça n’est qu’une affaire
de quelques molécules mues par le hasard et la nécessité.
Il est vrai que l’on sait aujourd’hui bricoler des génomes pour ajouter
ou enlever des ailes à une mouche, faire des poulets sans plumes ou des
souris fluorescentes. Est-ce que cela nous apprend quelque chose sur l’évolution
des espèces? pourquoi et comment le reptile est apparu? le mammifère?
la fleur?… Le néodarwinisme, qui se résume à des mutations
au hasard du matériel génétique et à la sélection
naturelle, explique dans une certaine mesure l’adaptation des espèces,
en aucun cas leur évolution.
Pourtant nous avons sous les
yeux des exemples remarquables qui suggèrent que d’autres processus sont
à l’œuvre dans l’évolution des espèces. Il s’agit des co-évolutions.
Il existe de nombreux cas fort bien documentés mais hélas largement
ignorés des chercheurs épris de manipulations génétiques.
Voici deux exemples parmi les plus fascinants:
l’orchidée marteau
 |
orchidée
marteau drakaea livida |
La scène se
déroule en Australie, dans une région chaude et sèche où
les incendies naturels sont fréquents, tellement fréquents que
la vie s’y est adaptée: les sauterelles sont noires, les araignées
couleur de cendre, les arbres se couvrent de plusieurs écorces pour se
protéger, les fruits résistent au feu, les plantes vivent en grande
partie sous la terre, suivies par de nombreux insectes, dont la guêpe
thynnidée. La femelle a perdu ses ailes parce qu’il est impossible de
travailler sous terre avec d’aussi encombrants appendices. Elle pond ses œufs
sur les racines d’un buisson parasité par des larves de scarabées
dont se nourrissent ses propres larves. Voici résolu une partie de son
problème. Reste celui de la fécondation. Pour qu’elle ait lieu,
la guêpe femelle grimpe au sommet d’une haute fleur et émet sa
phéromone. Le mâle, qui lui n’a pas perdu ses ailes, patrouille
depuis déjà trois semaines, car un décalage existe dans
la venue au monde des deux sexes. Son état de privation le rend extrêmement
sensible. Dès qu’il perçoit le signal odorant, il remonte la piste.
Une fois en vue de l’objet de son désir, il descend en piqué,
agrippe la femelle, et l’emporte dans les airs pour la féconder en plein
vol. De temps en temps, il fait halte sur une fleur pour s’alimenter, et donner
à la femelle l’unique repas de sa vie: il mange le pollen, le digère
partiellement, et le restitue à la femelle. Ce travail accompli, il la
dépose au pied d’un buisson, celui justement dont les racines sont parasitées
par les larves d’un scarabée. Le cycle de vie de la guêpe est bouclé,
et nous pouvons passer au second protagoniste de cette folle histoire.
L’orchidée marteau,
comme presque toutes les orchidées, a des problèmes de fécondation.
Pour le résoudre, elle se sert de la petite thynnidée, profitant
des trois semaines durant lesquelles le mâle est seul. La technique qu’emploie
le mâle pour féconder la femelle est si spéciale que l’orchidée
a du inventer un dispositif encore plus spécial. Pour commencer, elle
a fabriqué un leurre de la guêpe femelle: tête brillante,
corps rond et poilu, jusqu’à l’odeur qui est analogue à la phéromone
synthétisée pour attirer le mâle. Mais si l’orchidée
s’était contentée de disposer ce leurre comme précédemment
dans la corolle, elle n’aurait rien gagné puisque cette guêpe atterrit
pour redécoller aussitôt avec sa dulcinée. Au lieu de cela,
elle l’a placé au bout d’un bras, long d’environ 6 cm, articulé
sur une charnière élastique. Voici donc notre guêpe mâle
qui pique sur le leurre et l’agrippe. Croyant tenir une femelle, il bat des
ailes pour redécoller. Mais à cause du bras articulée,
il se met à décrire un arc de cercle, et vient cogner une sorte
d’enclume. La charnière élastique fait revenir le tout en arrière.
Le mâle recommence, s’obstine, et vient à nouveau frapper l’enclume.
Au bout d’un moment, sans doute lassé, il finit par lâcher prise
et s’envole pour de bon.
S’il est déçu,
l’orchidée elle a de quoi être satisfaite. En effet, l’enclume
contient des sacs de pollen et un stigmate, c’est-à-dire un organe femelle.
En se cognant dessus, l’insecte a accroché les sacs sur son dos. Et s’il
en avait déjà provenant d’une autre orchidée marteau, il
les a déposés sur le stigmate, fécondant ainsi la fleur.
Il faut remarquer que la réalisation
du marteau et de l’enclume sont proprement extraordinaires. L’orchidée
ne s’est pas contentée d’imiter à la perfection la guêpe
femelle, c’est-à-dire à la perfection pour le regard de la guêpe
mâle. Elle a aussi ‘calculé’ avec une grande précision tous
les éléments du dispositif. En particulier, le marteau se bloque
à une courte distance de l’enclume correspondant à l’épaisseur
du thorax de l’insecte, car il doit juste frapper l’organe sexuel de la fleur,
non être assommé. Non contente d’avoir inventé tout ça
une première fois, l’orchidée a aussi trouvé le moyen de
l’intégrer dans son génome pour le transmettre à sa descendance.
(d’après nos
pensées créent le monde chapitre 3)
le calamar luminescent
 |
calamar
luminescent |
Euprymna scolopes
est un calamar qui vit à Hawaï. Le jour, il reste enfoui sous le
sable des hauts fonds; la nuit, il sort de sa cachette et part en quête
de nourriture près de la surface. Par les nuits de Lune, vue depuis le
fond de ces eaux claires du Pacifique, sa silhouette se détache nettement
comme une tache sombre mouvante: une proie toute désignée pour
les prédateurs qui nagent en dessous.
Pour se rendre moins vulnérable,
Euprymna scolopes a trouvé une solution originale: il émet
une lumière diffuse qui se confond avec celle de la Lune réfractée
par les vaguelettes en surface. Elle jaillit d’un organe lumineux spécialement
dédié. Celui-ci est doté de dispositifs sophistiqués
lui permettant de canaliser et de réguler le flux lumineux afin de mieux
se fondre mimétiquement dans la clarté nocturne: il y a un système
de fermeture, l’organe est recouvert d’une lentille transparente muni d’un filtre
jaune, tandis que le fond est tapissé d’un tissu réfléchissant
couleur argent.
Comment le calamar produit-il
sa lumière? Un début de piste: des bébés calamars
élevés dans un milieu stérile ont un organe lumineux atrophié
et ne produisent aucune lumière. La responsable du phénomène
luminescent est une bactérie appelée Vibrio fischeri. C’est
elle qui tout à la fois stimule le développement de l’organe et
produit la lumière.
Dans les relations symbiotiques
entre des organismes complexes et des bactéries, le symbiote est généralement
transmis directement à l’hôte par les parents. Tel n’est pas le
cas ici. Le bébé calamar naît sans son symbiote. Celui-ci
vit dans la mer où le jeune calamar doit aller le chercher.
L’organe lumineux communique
avec l’extérieur par des petits pores. À l’entrée, il y
a de petits bras garnis de cils qui font circuler l’eau. Au rythme de deux millimètres
cube brassés chaque seconde, sachant qu’il y a environ 500 Vibrio
fischeri par millilitre cube d’eau, cela fait en moyenne une bactérie
de la bonne espèce qui approche toutes les secondes de l’entrée.
Mais approcher est une chose, pénétrer en est une autre, car un
tel courant a tôt fait de rejeter au loin ces organismes minuscules. Et
puis, c’est sans compter que toutes sortes de bactéries prolifèrent
dans ces eaux, dont l’animal n’a que faire.
Le petit calamar a trouvé
le moyen de retenir les Vibrio fischeri assez longtemps pour les inciter
à rentrer par les pores et coloniser son organe lumineux, tout en excluant
les autres bactéries. Pour ce faire, il sécrète une substance
mucilagineuse qui enrobe les petits bras de l’organe lumineux embryonnaire.
Les Vibrio fischeri viennent s’y coller, et, trouvant ce milieu à
leur goût, prolifèrent. Elles sont vite assez nombreuses pour que
quelques-unes décident de tenter leur chance ailleurs. Elles ne vont
pas bien loin: propulsées par leur flagelle, elles s’insinuent dans les
pores, et parviennent finalement dans l’organe lumineux.
La présence du symbiote
est vite détectée par le calamar qui fait régresser les
petits bras devenus inutiles. Il influence également le symbiote: les
bactéries perdent leur flagelle, diminuent de taille, et commencent à
émettre de la lumière. Quelques semaines après le début
de la colonisation, l’organe lumineux est pleinement opérationnel. Le
calamar dispose d’un moyen de camouflage efficace contre les prédateurs
qui hantent les fonds marins la nuit, et les bactéries trouvent au sein
de leur hôte protection et nourriture.
Pour boucler la boucle, chaque
matin, le calamar expulse les neuf dixièmes des bactéries qui
peuplent son organe lumineux. Cela assure une présence permanente de
Vibrio fischeri dans l’eau de mer.
Un nouveau bébé
calamar sort de l’œuf, ses petits bras enduits de mucus battent l’eau devant
l’organe lumineux, des bactéries s’y collent, et l’histoire recommence…
Mais l’histoire ne se répète
jamais exactement à l’identique. En tout cas, celle-ci a dû avoir
un curieux commencement, car nous voici au cœur d’un mystère. Il se trouve
en effet qu’en dehors de l’organe lumineux du calamar, les bactéries
Vibrio fischeri ne produisent pas de lumière. Pour en émettre,
il leur faut auparavant échanger des signaux chimiques. La concentration
de ces signaux dans l’eau libre est en général insuffisante pour
déclencher une émission lumineuse. Et quand bien même quelques
bactéries se mettaient à rayonner, elles passeraient inaperçues
tant l’intensité est faible, sans compter que cela constituerait un gaspillage
d’énergie. En revanche, au sein de l’organe lumineux du calamar où
la nourriture est abondante, les bactéries prolifèrent. Leur densité
devient telle que le signal chimique finit par être suffisamment fort
pour déclencher l’émission de lumière. Elles sont si nombreuses
que l’addition de tous ces rayonnements infimes produit une luminescence parfaitement
visible.
Questions: Qu’est-ce qui a
incité les ancêtres de ces calamars à s’associer avec ces
bactéries pour faire fonctionner leur organe lumineux, sachant que celles-ci
ne produisent pratiquement pas de lumière perceptible en dehors dudit
organe? Comment ont-ils fait ensuite pour procurer à Vibrio fischeri
et à elle seule un environnement favorable à sa croissance? Comment
la bactérie a-t-elle développé un double mode d’existence:
en eau libre avec un flagelle, et dans l’organe lumineux sans son flagelle?
Quels moyens de communication ont été conçus pour signaler
à l’hôte la présence de son symbiote afin de stimuler le
développement de l’organe lumineux? Beaucoup de questions, et guère
de réponses pour l’instant. Le temps, le hasard et la nécessité,
des essais et des erreurs, voilà comment les deux espèces en seraient
arrivées là si l’on en croit la plupart des scientifiques. On
ne saurait s’en satisfaire quand on constate que de tels cas de symbioses sont
légion, qu’il n’y a guère de ratés, et que la Nature n’a
pas vraiment pris le temps de flâner.
Au-delà de ces questions,
on ne peut s’empêcher de s’en poser une autre : où le calamar est-il
aller pêcher cette drôle d’idée selon laquelle rendre son
corps luminescent le protègerait des prédateurs? Encore une fois,
prétendre que c’est le fait du hasard et du temps n’a aucun sens. Son
ancêtre n’a pas eu des milliards d’années pour tenter toutes sortes
d’expériences. D’une part, il n’y a aucune trace de telles tentatives;
d’autre part la première erreur aurait été fatale, l’espèce
disparaissant sous la dent des prédateurs. Il n’y avait pas le choix,
cela devait réussir du premier coup. Mais alors, cela veut dire que "quelque
chose" avait d’une manière ou d’une autre la perception de la situation
globale: le calamar nageant près de la surface, la clarté nocturne
au-dessus réfractée par les vagues, la silhouette se détachant
lorsqu’elle est vue du fond par un prédateur, Vibrio fischeri
émettant de la lumière, un futur organe lumineux qui abriterait
une colonie de bactéries… En plus de cette connaissance, il devait y
avoir une forme d’intelligence créative pour projeter l’idée que
rendre ce corps luminescent constituerait une réponse appropriée
au danger. Où se situe cette intelligence? Réside-t-elle dans
le code génétique, en deçà, au-delà? Est-elle
toujours à l’œuvre? Qui sait, en se poursuivant, cette co-évolution
donnera peut-être naissance à une nouvelle espèce, un calamar
qui brillera par lui-même, ayant intégré dans son génome
celui de la bactérie…
(extrait de le
grand roman des bactéries, chapitre 5)
Difficile de concevoir que la forme de l’orchidée marteau, de l’organe luminescent du calamar Euprymna scolopes, des ailes du papillon Kallima ou encore de la fleur corail soient des ‘inventions’ du hasard et de la nécessité. Tout se passe comme si une intention était à l’œuvre. Est-ce une pure intention jaillissant d’une vacuité de type bouddhiste ou quantique? y a-t-il un penseur derrière cette pensée, voire une multitude de penseurs? Mystère. Ce n’est d’ailleurs pas le lieu d’approfondir cette question. Le lecteur intéressé trouvera matière à réflexions dans d’autres de mes ouvrages: nos pensées créent le monde, le jeu de la création, vers l’homme de demain, le grand roman des bactéries. Pour l’heure résumons l’essentiel de ce qui semble à l’œuvre dans l’évolution des êtres vivants:
Je ne prétends pas que ceci suffit pour expliquer tout de l’évolution du vivant: c’est une piste pour construire un modèle alternatif à l’actuel néodarwinisme largement incompétent sur ce sujet; un modèle plus compréhensif qui conduit à élargir notre Vision de la Nature et de l’homme; un modèle fécond pouvant être décliné dans d’autres domaines, par exemple l’architecture. J’insiste, il ne s’agit pas de la millionième vérité d’où découle nécessairement une architecture naturelle finalement dans le vrai pour tous en tous temps et tous lieux. Il s’agit d’une manière d’aborder l’architecture qui se veut cohérente avec une certaine Vision de la Nature, de l’homme, et de l’évolution. C’est tout, et ce n’est déjà pas si mal de commencer à être un peu plus conscient des jeux que l’on joue entre esprit et matière, à ce point de jonction qui est l’essence même de l’incarnation, et que l’architecture à son tour permet d’explorer, dans une moindre mesure évidemment que notre corps, mais dans une mesure utile, intéressante, féconde.
Avant d’envisager
de transposer ce modèle à l’architecture il est nécessaire
de s’interroger sur la légitimité pour l’homme à
imiter la Nature dans son fonctionnement le plus intime, créer. D’ailleurs
à ce niveau on ne peut plus considérer qu’il s’agit d’imitation
mais plutôt de l’expression d’une même faculté. Cette interrogation
sur la faculté de l’homme à créer renvoie donc à
des questions plus métaphysiques concernant l’idée qu’il a de
lui-même, de la Nature, de la genèse du monde.
Il est des cultures qui lui
dénient tout pouvoir de créer, ou qui, le reconnaissant, lui en
limitent l’usage jusqu’à même l’interdire. L’Islam par exemple.
Depuis qu’il s’est figé dans son dogme au 11e siècle, plus grand
chose n’en est sorti. Pourquoi faudrait-il créer, évoluer, puisque
le monde est achevé ainsi qu’Allah l’a voulu et que l’homme n’est
pas là pour le perfectionner, seulement pour se soumettre (islam
veut dire soumission) au créateur unique de toutes choses? (cf. les
grandes civilisations, chapitre la civilisation islamique)
Différente
est la Vision des peuples primitifs, quoique aboutissant sur cette question
au même résultat, à savoir ne pas évoluer. Notons
au préalable ce fait significatif: beaucoup se nomment eux-mêmes
l’homme ou tous les hommes ou le peuple ou le vrai peuple, ce
que veulent dire littéralement Inuits, Sioux, Alamans, etc. Tous ces
‘vrais’ hommes se considèrent comme émanation de la Nature
au même titre que les végétaux et les animaux, nés
de la terre, du Soleil, du vent et des eaux. Ils sont toujours liés en
esprit à leurs frères et sœurs animaux et végétaux,
ainsi qu’aux rivières, aux montagnes et aux forêts. Ce n’est pas
qu’un lien symbolique à travers des mots et des figurations, ou pratique
à travers la nourriture et les plantes médicinales ingérés.
C’est un lien expérimenté directement de l’intérieur dans
des états de transes chamaniques. Pour certains peuples l’union est si
profonde que même l’agriculture est taboue car cultiver équivaut
à déchirer la peau de la Terre-Mère.
Ils ne sont plus très
nombreux ces lointains descendants de nos ancêtres communs du paléolithique.
Quelques milliers tout au plus de bushmen, d’aborigènes australiens,
plus quelques tribus dispersées dans l’immense forêt amazonienne.
Plus très nombreux et de moins en moins nombreux, en passe même
de disparaître. Leur esprit enfantin ne pouvait pas grand chose contre
la rougeole et la variole; leurs jeux de guerre ritualisés ne pouvaient
rien face à des fusils; leur loi orale ne peut rivaliser contre des traités
écrits jamais respectés; leurs territoires sont avalés
par des bulldozers et autres charrues; surtout, leurs croyances fossilisées
ne sont pas en accord avec la mobilité de l’esprit humain. Ils disparaîtront
avant l’Occident, c’est probable, et tout ce que l’on peut espérer c’est
que quelques unes de leurs croyances les plus sensées leur survivront
et resteront même vivantes. Par exemple la communion d’esprit entre l’homme
et la Nature, déjà reprise par diverses mouvements qui vont du
néo-chamanisme à la deep-ecology. On en voit aussi le prolongement
en architecture avec la redécouverte du tipi, de la yourte, des méthodes
ancestrales de construction en terre (adobe), de creusement d’habitats troglodytes,
etc.
Quelle distance avec
un mode de vie occidental urbanisé, où la nourriture s’achète
prête-à-manger, où la ‘vraie’ vie est de plus en plus virtuelle!
Deux exemples à l’extrême opposé pour souligner la variété
de croyances que l’homme est capable d’inventer. Les nôtres ne
sont qu’un choix parmi d’autres quant à ce que l’on est désireux
de vivre en rapport avec la Terre. Ce choix s’est esquissé avec l’invention
de l’agriculture, s’est renforcé avec la religion judéo-chrétienne
qui ignore tout de la Nature, pour aboutir aux 17 et 18e siècles à
une véritable doctrine de soumission de la Nature au seul bénéfice
de l’homme, blanc si possible. Nous vivons en plein les conséquences
de cette Vision du monde. Pour le meilleur et pour le pire…
Remarquons que si maintenant
certaines actions sont de plus en contestées, comme les rejets massifs
de gaz carbonique et autres pollution, cela ne conduit pas toujours à
une remise en cause de cette Vision génératrices desdites actions.
Au vu de ses récents méfaits à l’encontre de la planète,
des autres espèces et de lui-même, quelques uns sont bien tentés
d’ôter à l’homme le droit de faire tout et n’importe quoi.
Principe de précaution à la mode oblige. Mais c’est toujours dans
son propre intérêt sans guère de considération pour
la Nature elle-même: la pollution ne le concerne que dans la mesure où
sa santé en pâtit, la biodiversité ne l’intéresse
que dans la mesure où il pourrait y trouver les remèdes de demain,
l’étude du requin ne l’intéresse que pour améliorer les
performances de ses sous-marins… Pour le reste, vive la croissance, la solution
insensée à tous les problèmes socio-économiques
et même psychologiques. Problèmes dont elle est d’ailleurs à
l’origine. À quand la décroissance?
On l’aura compris, je ne me reconnais dans aucune de ces positions extrêmes. Je développe abondamment ma Vision dans d’autres ouvrages. Je n’y reviendrai pas et me contenterai de souligner ces quelques points en rapport avec le présent propos et faciles à comprendre sans références aux dits ouvrages:
1. La faculté créatrice est en l’homme, c’est pour moi un fait indéniable. De nombreuses créations humaines qui suscitent des sentiments sublimes en témoignent:
À considérer aussi l’énorme créativité mise dans la production de fantasmes en tous genres, de mensonges plus ou moins gros, de parades vestimentaires, d’obsessions culinaires, et autres traits d’ironie ou d’humour qui pimentent notre quotidien, c’est bien que cette faculté est en nous. Je vois mal dieu ou même le diable occupant leur temps à nous inspirer tout cela. Et pas davantage à nous inspirer une coupole d’église ou un requiem…
2. Étant admis que cette faculté est en lui, il ne peut pas ne pas en faire usage car elle est son identité profonde, tout comme elle est au cœur de la Nature. Remarquons en passant que celle-ci est tout aussi instable, brouillonne, immature et exploratrice insatiable que nous le sommes. Deux arguments suggérant qu’elle n’est pas si parfaite que certains voudraient le croire. D’abord les bactéries sont à l’origine de la plus gigantesque pollution de tous les temps. Cela s’est produit il y a environ deux milliards d’années lorsqu’elles ont commencé à déverser en grandes quantités dans l’atmosphère de … l’oxygène! celui-là même que nous respirons, ce qui prouve que la vie a fini par s’y adapter, à faire même de cette pollution un avantage (voir le grand roman des bactéries). Et puis on estime que depuis près de quatre milliards d’années que la vie est présente sur cette planète, entre 95 et 99% des espèces créées ont disparu, pour des raisons qui ne doivent pas toutes à des catastrophes ni à l’homme. Donc après avoir commis l’erreur de nous surévaluer, ne commettons pas celle de surévaluer la Nature. Ce n’est évidemment pas un blanc-seing pour faire n’importe quoi. C’est un encouragement à davantage de conscience, tirer les leçons de nos expériences passées pour en créer de nouvelles moins délétères et plus enthousiasmantes, toujours curieux et gourmands d’explorer les multiples facettes de notre esprit créateur reflété dans la matière.
3. C’est d’autant moins une permission de faire n’importe quoi que l’homme, dans sa forme actuel, restera toujours profondément lié à la Terre. Qu’il le veuille ou non. Le lien le plus visible est évidemment matériel. On respire, on boit, on mange ce que d’autres ont respiré, bu, mangé, pour finir dans la terre, dans l’eau, dans l’air, nourriture pour d’innombrables êtres vivants. Sans les bactéries, sans les végétaux, sans les animaux, sans le Soleil, nous n’existons pas en tant qu’êtres incarnés sur cette planète. D’autant qu’un lien plus subtil unit tout-ce-qui-vit. Les chamans ont raison, dans certains états de conscience, il est possible de rencontrer l’esprit des végétaux ou des animaux (parmi une abondante et inégale littérature sur le chamanisme, je recommande le serpent cosmique de Jérémy Narby, éditions Georg). Personnellement j’ai vécu une transformation en serpent que je relate dans vers l’homme de demain. Qui sait, c’est peut-être ce lien entre espèces qui explique aussi les co-évolutions, comme celle de la guêpe et de l’orchidée…
Bref, telle est la base métaphysique sur laquelle je vais tenter de construire une architecture physique.
Compte tenu de tout ce qui précède, voici le dernier (en date et pas forcément définitif) point de vue sur l’architecture naturelle calqué cette fois sur l’évolution des êtres vivants telle que je la conçois: 1. créativité, 2. sens, 3. en matière de moyens, tout est bon.
Détaillons,
en remarquant pour commencer que l’architecture est pleine de créativité
même si elle se complait dans la répétition ou se dissimule
derrière des vérités prétendument extérieures
à l’homme voire carrément révélées.
La géométrie en est une preuve. Voici à ce propos cette
intéressante expérience relatée par Tadao Ando:
"C’est lorsque je me suis
retrouvé à l’intérieur du Panthéon, à Rome,
que j’ai pris, pour la première fois, réellement conscience de
la notion d’espace architectural. Ce que j’ai expérimenté à
ce moment-là n’était pas un espace au sens conceptuel du terme.
C’était indiscutablement un espace bien réel qui s’offrait à
ma vue. Comme chacun sait, le Panthéon est composé d’un mur cylindrique
coiffé d’un dôme hémisphérique. Le diamètre
du cylindre et celui de la coupole sont de même dimension, et, tout comme
la hauteur du bâtiment, mesurent 43,2 mètres. Par conséquent,
on peut dire que, globalement, la forme du Panthéon est une immense sphère.
Lorsque l’intérieur de cette construction aux formes géométriques
simples est illuminé par les rayons du Soleil (diffusés grâce
à l’oculus de 9 mètres de diamètre situé au sommet
du dôme), alors l’espace architectural devient tangible. On ne pourrait
jamais ressentir dans la nature cet effet né de la matière et
de la lumière. Une telle scène n’est possible que dans l’architecture,
un ensemble de formes conçues par l’esprit humain. Cette ‘force’ dont
l’apparition m’a bouleversé, je veux lui donner le nom d’architecture."
(Tadao Andô, lieu-géométrie-nature, texte reproduit
dans l’ouvrage que lui consacre Yann Nussaume, p 218, éditions le moniteur
1999)
S’agissant du sens, l’architecture de tous les temps et de tous les lieux en est pleine même si l’on s’illusionne souvent sur les vraies raisons conduisant à attribuer aux formes telles ou telles signification. On l’a bien vu à propos de la géométrie ainsi que des diverses variantes d’architecture naturelle. Cela vaut aussi pour le tipi, la yourte, la maison traditionnelle chinoise, japonaise, indienne, etc.
S’agissant des moyens, reconnaissons que ce n’est que récemment que l’on a commencé à y mettre davantage de créativité pour dépasser les logiques d’empilages et d’assemblages hiérarchisés. Frei Otto et quelques autres cités dans le livre 1 montrent qu’il est possible de faire preuve d’imagination pour construire différemment, en jouant avec la matière sans être limité par elle, exactement comme fait la Nature.
Nous voici parvenus à un point très surprenant et intéressant puisqu’il apparaît que le modèle de morphogenèse architectural inspiré de la morphogenèse des êtres vivants s’applique à toutes les architectures, du fonctionnalisme à l’organicisme, du symbolisme au monumentalisme, du modernisme au déconstructivisme, sans compter les innombrables variantes d’architectures traditionnelles. Une fois admise la possession par l’homme de la faculté de créer et son droit voire son devoir d’en faire usage, le fond du problème devient celui du sens, on y revient toujours. C’est là que toutes les approches architecturales se différencient; c’est là qu’achoppe l’architecture actuelle dans son ignorance de l’homme et son mépris de la Nature; c’est le sens encore qui oriente la créativité pour faire émerger telles formes et tels procédés de construction; c’est donc cela qu’il faut maintenant explorer: quelle architecture pour quel homme?